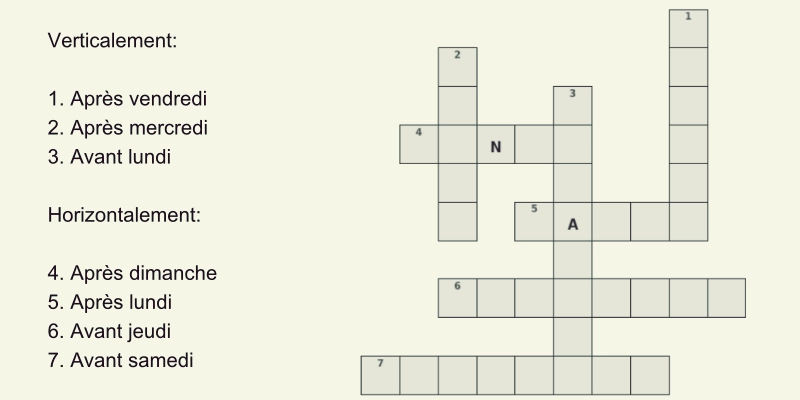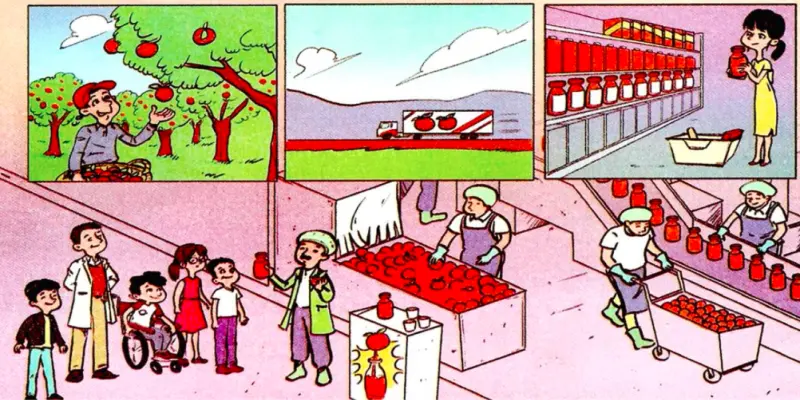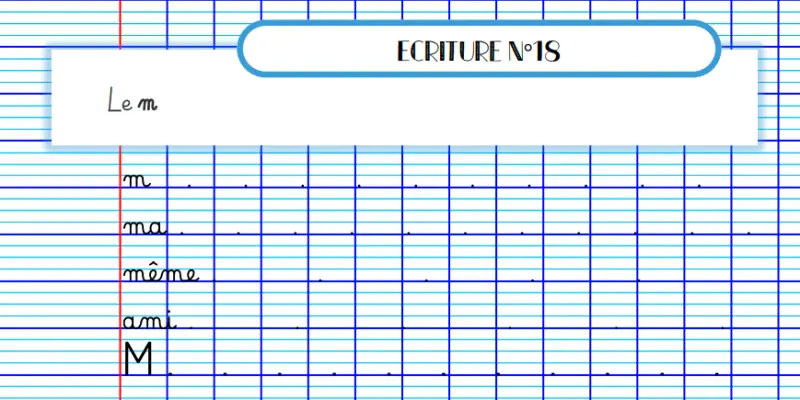Résumé
La transition didactique est un choix pédagogique qui permet aux apprenants assimiler les connaissances scolaires progressivement avec l’aide de l’enseignant. C’est donc un processus qui nécessite l’intervention de tous les acteurs de l’éducation, depuis les responsables des programmes scolaires jusqu’aux enseignants, en ce qui concerne la définition des objectifs, des compétences et de la manière de construire les connaissances pour les adapter aux besoins et aux capacités cognitives des apprenants. Effectivement, la transposition didactique n’est pas une recette prête à l’emploi, mais un processus qui nécessite l’exploitation d’un ensemble de ressources cognitives et didactiques pour réussir le cours de philosophie.
Mots-clés : la transition didactique – philosophie – situations problématiques – textes philosophiques.
Introduction
La didactique est l’art d’enseigner ou l’étude scientifique des méthodes et des techniques d’enseignement, ainsi que des formes d’organisation des situations d’apprentissage. Elle fait appel à des domaines tels que la psychologie, la sociologie et l’épistémologie. En effet, Le processus d’enseignement-apprentissage repose sur le triangle didactique, qui met en évidence les relations entre trois pôles à savoir l’enseignant, l’apprenant et le savoir. La relation entre l’enseignant et l’apprenant est de nature pédagogique (le contrat didactique), celle entre la matière et l’apprenant est psychologique (les représentations), tandis que la relation entre l’enseignant et la matière d’étude est de nature épistémologique (le transfert didactique). Cette dernière exige que l’acteur intervenant respecte certaines conditions.
Cette étude vise à clarifier la question du transfert didactique et ses conditions épistémologiques en mettant en évidence la spécificité de ce composant dans l’enseignement de la philosophie. À ce propos, si le transfert didactique consiste à transformer des connaissances pures en connaissances scolaires prenant en compte le développement intellectuel, psychologique et mental de l’apprenant, nous nous demandons comment peut-on réaliser cette possibilité dans le domaine de la philosophie ? Autrement dit, Comment on-peut atteindre les objectifs du transfert didactique dans un domaine où les concepts sont soumis à des conditions historiques et culturelles particulières ?
La transposition didactique
La transposition didactique selon Yeves Chevallard (1985/1991) est un mécanisme qui permet de rendre le savoir savant accessible à enseigner aux étudiants : «Le “travail” qui d’un objet de savoir à enseigner fait un objet d’enseignement est appelé la transposition didactique»1. Ce concept a été introduit en 1975 par le français Michel Verret pour désigner un phénomène qui dépasse l’école et les disciplines. Ainsi, le transfert didactique est le processus qui permet de transmuer des connaissances académiques en connaissances scolaires tout en prenant en compte les spécificités psychologiques des apprenants et en répondant à leurs besoins. Le transfert didactique se réalise à travers deux niveaux fondamentaux et interconnectés : la transposition didactique externe et la transposition didactique interne.
D’abord, il y a le transfert didactique externe qui est réalisé par les acteurs intervenants qui préparent les programmes scolaires. Ensuite, il y a le transfert didactique interne effectué par l’enseignant en adaptant le contenu des manuels scolaires aux capacités des apprenants. En outre, le transfert didactique constitue le centre opérationnel des processus didactiques «du processus de transposition […] est la noosphère2»3, c’est-à-dire l’ensemble des acteurs intervenant à l’intersection du système d’enseignement et de la société (les parents, les savants et l’instance politique décisionnelle). Ainsi, la nécessite de respecter plusieurs critères, tant au niveau de l’élaboration des programmes scolaires qu’au niveau de la réalisation des cours par l’enseignant. Parmi ces critères importants, nous jugeons utile de retenir les plus importants :
- Tenir compte de l’âge des élèves ciblés dans le processus d’enseignement;
- L’ajustement cognitif par l’acteur éducatif des concepts à enseigner;
- Cibler des compétences spécifiques et des capacités des apprenants;
- Choisir des situations didactiques appropriées et variées;
- Comprendre les obstacles cognitifs liés aux concepts ciblés (exploiter les recommandations des conseils de départements);
- Objectivité dans le processus de transfert didactique, en accord avec les orientations pédagogiques encadrant le programme d’études.
La transposition didactique en philosophie
Ce qui distingue le savoir savant ou académique, c’est qu’il s’agit d’un savoir abstrait, c’est-à-dire lié à un niveau intellectuel appelant à l’apprenant à s’affranchir du sensoriel pour parvenir à la compréhension. C’est une caractéristique qui caractérise les connaissances humaines telles que la philosophie, la psychologie, la sociologie, la linguistique et même les connaissances scientifiques telles que la physique, la biologie et les mathématiques. Cette dernière, par exemple, exige de l’apprenant en terminale une capacité d’abstraction au niveau de la compréhension, car ce qui régit les mathématiques est la logique pure qui nécessite une compréhension de sa langage symbolique. Les nombres ou les formes géométriques sont, en fait, de pures constructions mentales qui n’ont pas d’équivalent dans la nature. Mais les études épistémologiques du philosophe allemand Edmund Husserl ont montré que les Entités mathématiques étaient issues du monde vécu pour devenir des formes géométriques idéales. Il en va de même pour les concepts philosophiques (liberté, justice, droit…) issus de la réalité humaine. Ainsi, l’abstraction est un processus de développement de l’esprit humain et du langage utilisé pour exprimer les connaissances scientifiques. Les études psychologiques de Piaget ont révélé comment l’intelligence de l’enfant se développe de son niveau sensoriel à son niveau abstrait. Le processus d’abstraction ne se produit pas d’un seul coup, mais il est le résultat d’un chemin de développement auquel les données externes (l’environnement) et les données internes de l’individu (le biologique) jouent un grand rôle. En fait, ce modèle correspond à l’évolution de l’histoire de l’esprit humain depuis son niveau sensoriel-mythique jusqu’au niveau abstrait-philosophique.
Le succès du processus de transfert didactique accompli par l’enseignant est conditionné par la réalisation du transfert didactique externe confié aux concepteurs des programmes et au curriculum de la matière philosophique. Par conséquent, ce processus est encadré par des directives pédagogiques respectant un ensemble de spécifications énoncées dans des documents définissant la politique éducative au Maroc (Charte de l’éducation et de la formation). Au niveau théorique, les grandes spécifications de la matière philosophique sont définies comme une connaissance générale englobant à la fois les connaissances scientifiques, littéraires et artistiques, une connaissance critique contribuant à la construction de la personnalité de l’apprenant en matière d’indépendance et de libération de toute forme de pensée négative. Les méthodes pédagogiques à adopter sont également spécifiées: l’approche par compétences, l’approche par les valeurs, l’approche par modulation et l’adoption de méthodes d’activation interactive. De même, les principes généraux que le responsable du programme d’études et le manuel scolaire doivent respecter sont définis comme la nécessité de respecter la progression en tenant compte du niveau d’âge intellectuel et psychologique de l’apprenant. Ainsi, la première année du tronc commun, en tant que première étape où l’apprenant entre en contact avec la leçon philosophique est conçue comme une année d’introduction à ce mode de pensée de manière simplifiée pour faciliter la compréhension de certaines notions. Cela permet de progresser vers la phase de pratique de la philosophie à travers des concepts et des questions basés sur des textes, jusqu’à atteindre la capacité de philosopher dans le but de mettre en évidence ses compétences personnelles en matière de philosophie et de pensée indépendante en s’appuyant sur la problématisation, la compréhension et l’argumentation.
Le processus de transfert didactique interne réalisé par l’enseignant exige le respect du principe selon lequel l’acte d’enseigner est un acte visant à aider, stimuler et faciliter l’acquisition d’apprentissages autonomes par l’apprenant. «La réforme de l’éducation et de la formation place l’apprenant, en général, et l’enfant en particulier, au centre de la réflexion et de l’action pédagogiques. Dans cette perspective, elle se doit d’offrir aux enfants du Maroc les conditions nécessaires à leur éveil et à leur épanouissement.4». En harmonie avec la vision des compétences en tant qu’action et transformation du comportement, avec la nécessité de s’adapter à l’environnement en vue de résoudre les problèmes. Ainsi, le processus de transfert didactique suppose l’utilisation de situations problématiques en philosophie pour connecter l’apprenant à son monde vécu, afin de stimuler la réflexion des apprenants. Ces situations nécessitent la destruction de la structure cognitive de l’apprenant qui contribue à sa reconstruction, c’est-à-dire que la situation problématique est une situation qui suscite une tension chez l’apprenant, le poussant à rechercher des solutions basées sur ses acquis antérieurs. Par conséquent, la situation problématique est un choix didactique qui impliquant apprenants dans des questions philosophiques soulevées par les philosophes.
La transposition didactique du texte philosophique
Avant d’aborder la question de la possibilité de la transmission didactique du texte philosophique, il est nécessaire de définir ses caractéristiques fondamentales sans s’étendre sur les différences théoriques dues à la diversité des approches. Le texte philosophique est le produit d’une pensée qui interagit avec la langue pour créer des concepts philosophiques. Cette langue tire sa spécificité de son utilisation, c’est-à-dire de son aspect sémantique qui répond aux préoccupations existentielles. Par conséquent, parler du texte philosophique revient à aborder de la nature de la philosophie et de l’écriture philosophique. Mais ce qui distingue le texte philosophique, c’est sa dimension intertextuelle, c’est-à-dire sa capacité à tisser des liens avec d’autres textes, que ce soit par l’inclusion, la transformation, le transfert ou la confrontation. C’est ce qui lui confère un caractère dynamique et évolutif.
Julia Kristeva a identifié trois structures fondamentales du texte en général : la structure sémantique, la structure textuelle et la structure culturelle.
Étant donné que le texte philosophique est un discours fixé par écrit, selon Paul Ricœur. Interpréter donc, pour lui, c’est se comprendre soi-même devant le texte, comprendre soi-même comme un autre par la médiation du texte «Se comprendre, c’est se comprendre devant le texte et recevoir de lui les conditions d’un soi autre que le moi qui vient à la lecture. Aucune des deux subjectivités, ni celle de l’auteur, ni celle du lecteur, n’est donc première au sens d’une présence originaire de soi à soi-même»5. Ainsi, le lecteur a besoin d’appliquer des mécanismes qui lui permettent de comprendre le texte, regroupés principalement dans les mécanismes de l’interprétation et de l’explication. Cela signifie que le lecteur doit se doter de différentes méthodologies empruntées à la linguistique, à la psychanalyse, à l’histoire, etc. Quelle serait donc la méthodologie appropriée pour enseigner le texte philosophique de manière didactique ?
Chaque méthodologie adoptée pour lire un texte est temporaire, elle a une validité qui nécessite des ajustements et des développements. Au Maroc, la méthodologie adaptée à l’approche par compétences, visant les objectifs spécifiques : La problématisation, La conceptualisation, l’argumentation.
La dimension problématique
La pensée problématique en philosophie exprime la complexité qui touche les questions de l’existence humaine, c’est-à-dire qu’elle soulève des paradoxes visant à se libérer de l’autorité de la pensée dogmatique. De surcroît, la leçon de philosophie désigne, dans cette perspective, une expression ouverte des questions, et non point une interminable revue d’opinions diverses «La problématique n’acquiert évidemment sens qu’à l’intérieur d’une leçon qui est position mobile de questions, et non point discussion de doctrines»6. Le processus problématique du texte nécessite de passer des notions (lexicale, réel) au niveau des concepts (théorisation philosophique). Cela implique des procédures telles que :
- Placer le texte dans les axes déterminés;
- Déterminer la problématique du texte par rapport à la leçon;
- Problématisation du texte à travers la création des oppositions, de mises en difficulté et de paradoxes.
Ainsi la problématisation devient un exercice pour l’élève, parce que l’engage à réfléchir sur des questions liées à son existence humaine.
La dimension conceptuelle
Celle-ci implique d’explorer la structure sémantique en ouvrant la voie à ses significations profondes. Cela se fait en reconnaissant ses éléments intertextuels, permettant de déterminer la nature du texte (niveau historique, religieux, scientifique, philosophique), ainsi que sa forme intertextuelle (interne et externe) et ses mécanismes intertextuels (contradiction, critique, transformation, inclusion). De plus, elle implique d’adoption d’une lecture interprétative pour révéler l’intention du texte, tout en mettant en lumière sa logique interne et externe.
La dimension argumentative
Tout texte est un texte argumentatif car il repose sur un langage naturel. Ainsi, le processus d’argumentation constitue un exercice pour l’apprenant afin de comprendre les mécanismes utilisés par les philosophes pour défendre leurs thèses.
Conclusion
La transition didactique est un choix pédagogique qui permet aux apprenants assimiler les connaissances scolaires progressivement avec l’aide de l’enseignant. C’est donc un processus qui nécessite l’intervention de tous les acteurs de l’éducation, depuis les responsables des programmes scolaires jusqu’aux enseignants, en ce qui concerne la définition des objectifs, des compétences et de la manière de construire les connaissances pour les adapter aux besoins et aux capacités cognitives des apprenants. Effectivement, la transposition didactique n’est pas une recette prête à l’emploi, mais un processus qui nécessite l’exploitation d’un ensemble de ressources cognitives et didactiques pour réussir le cours de philosophie. Cela implique une progression dans la construction des connaissances au niveau de l’élaboration des programmes scolaires, le choix de situations problématiques, ainsi que la lecture des textes philosophiques. Tout à fait, elle fait partie des compétences professionnelles qui nécessitent une formation continue en matière de développement des connaissances philosophiques et didactiques. Il est également essentiel de rester ouvert aux expériences d’autres matières comme les mathématiques et d’échanger des expériences personnelles entre enseignants.
Références
- Yves Chevallard, La transposition didactique – Du savoir savant au savoir enseigné, La Pensée sauvage, Grenoble, deuxième édition 1991.
- Paul Ricœur, Du texte à l’action, Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986.
- Charte de l’éducation et de la formation, Maroc.
- Yves Chevallard, La transposition didactique – Du savoir savant au savoir enseigné, La Pensée sauvage, Grenoble, deuxième édition 1991, p. 39. ↩︎
- Noosphère: Ensemble des personnes qui ont une fonction à la fois dans le système d’enseignement et la société. Exemples : les parents, les savants, les personnes qui élaborent les programmes scolaires, font partie de la noosphère. Source : Dictionnaire des concepts fondamentaux de didactique. ↩︎
- Ibid., p. 39 ↩︎
- Charte de l’éducation et de la formation, p. 7, PDF, https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documentation%20iscae%20rabat%202018.pdf. ↩︎
- Paul Ricœur, Du texte à l’action, Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986, p. 31. ↩︎
- Sylvie SOLERE QUEVAL, La problématique dans la leçon, (La leçon de philosophie), C.R.D.P Lille, p. 125. ↩︎
Par KHALID BENCHANAA, professeur et chercheur en philosophie.